Éric Noël (il/iel) est un auteur, traducteur et performeur non-binaire établi à Tiohtià:ke/Montréal, diplômé de l’École nationale de théâtre en écriture dramatique (2009). Sa première pièce, Faire des enfants (Leméac, 2011), a remporté le prix Gratien-Gélinas. Il crée en 2023 L’Amoure Looks Something Like You (Hamac, 2022), un spectacle collectif LGBTQIA2S+ qui lui vaut le prix Michel-Tremblay 2024. Sa plus récente pièce, Ces regards amoureux de garçons altérés (Leméac, 2025), a été créée au Théâtre Prospero. Pour le jeune public, il a écrit entre autres Astéroïde B 612 (Leméac, 2021) et Des morceaux de lumière (2024), inspirée de témoignages de personnes dépendantes. Éric est aussi conseiller dramaturgique et médiateur culturel. Il a été président du CEAD de 2021 à 2025 et a récemment été nommé à la direction artistique et co-générale du Jamais Lu.
Bonjour Éric.
Tu abordes dans des pièces des sujets sensibles, parfois même tabous dans les communautés queers. Quelles sont tes motivations ou le message que tu souhaites porter lorsque tu écris sur ces sujets?
Je n'écris pas pour faire passer des messages. J'écris de manière instinctive, sur ce qui monte en moi, ce qui semble vouloir sortir. Toutes les fois où j'ai voulu écrire avec un plan très clair, cérébral et réfléchi, je me suis buté à un mur et j'ai fini par écrire ce qui demandait à être écrit, souvent à des miles de ce que je voulais faire au départ. Avec le temps, je me suis rendu compte que "ce que je veux écrire et dire" importe peu. Au final, l'écriture décide et mon terrain de jeu comme auteur est limité. J'ai une approche spirituelle à l'écriture et j'essaie d'écouter, d'être attentif à la vie autour de moi. Ce que je dois écrire s'y trouve. Et chaque projet est radicalement différent dans la manière dont il se manifeste.
Pour Ces regards amoureux de garçons altérés, j'ai tout simplement écrit ce que je vivais au moment où je le vivais. Je pratiquais le chemsex, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans les saunas et je vivais les hauts et les bas qui viennent avec la consommation de crystal meth. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait, cette perte de contrôle, cette transformation. Je mentirais si je disais que je voulais écrire pour sensibiliser ma communauté. Je voulais écrire ce texte parce que c'était la seule façon par laquelle je m'imaginais pouvoir parler de ce que je vivais. C'était un geste profondément personnel : je voulais, oui, me sauver. De toute façon, si je voulais être là pour les autres, il fallait d'abord que je sois là, que je m'en sorte, que je survive. Le désir que ce texte puisse questionner et servir ma communauté est venu. Mais il est venu bien plus tard.
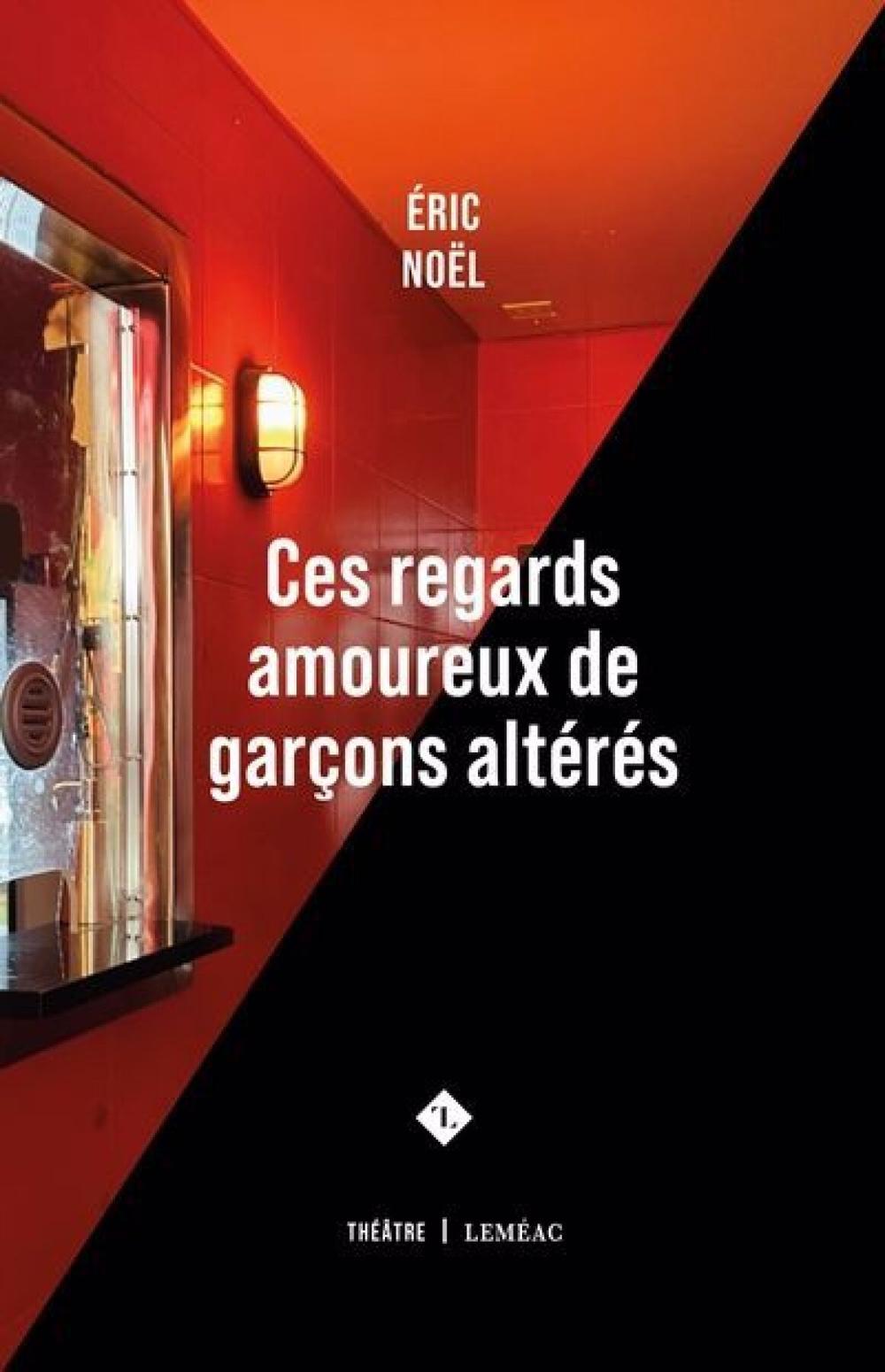
Noël, É. (2025). Ces regards amoureux de garçons altérés. Leméac.
Pour L'Amoure looks something like you, encore là, je n'aurais jamais imaginé que ce texte devienne ce qu'il est devenu. C'était au départ une petite commande pandémique, transformée en laboratoire, puis en performance que j'ai fait avec trois fois rien dans différents contextes très marginaux... puis finalement, grâce à la vision de Nicolas Gendron et du regretté Claude Poissant du Théâtre Denise-Pelletier, c'est devenu un réel happening queer et ça a pris une dimension politique plus forte, plus assumée. C'était nouveau pour moi. Je pense que c'est dû entre autres au contexte d'écriture : j'ai écrit ça sous pression en mai 2020, en plein début de pandémie, alors que les manchettes nous montraient des femmes trans assassinées, les manifestations du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd, une baleine à bosse qui nageait sous le pont Jacques-Cartier... Je ne pouvais pas me plonger dans une fiction en évitant ce qu'on était en train de traverser collectivement et qui était très troublant. Puis, personnellement, je vivais une transition sociale d'homme gai cis à personne non-binaire. Je m'exposais sur les médias sociaux, j'avais un grand besoin de dire et de montrer qui j'étais. De me comprendre.
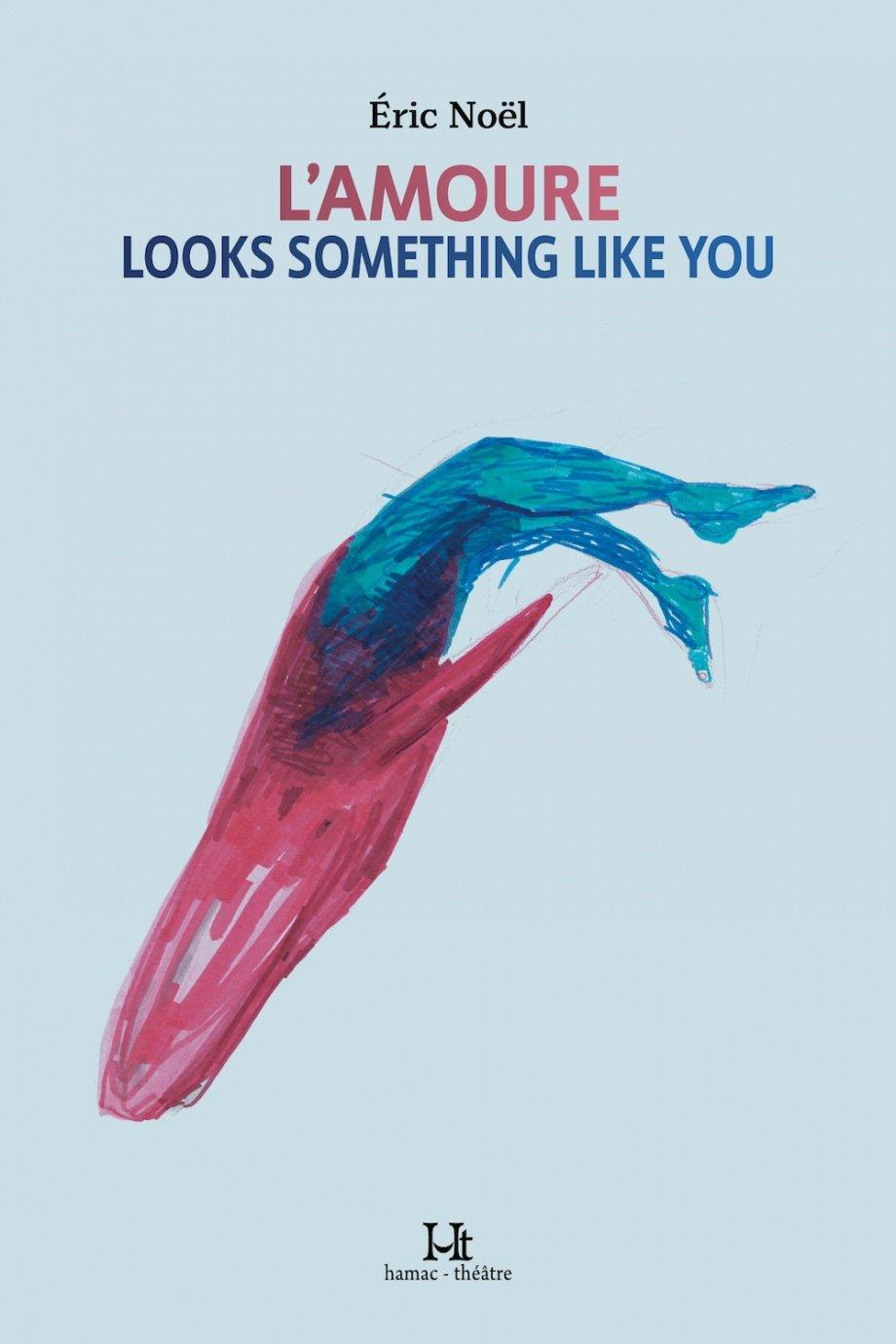
Noël, É. (2022). L’amoure looks something like you. Hamac.
C'est toujours par l'écriture que je finis par me découvrir. Et pour se découvrir, il faut aller dans les zones floues, parfois plus sombres ou cachées. On ne peut pas mettre en lumière ce qui brille déjà. Ce qui pour moi crée une émotion, c'est de voir apparaitre quelque chose qui était caché - que ce soit la porte d'une chambrette de sauna qui s'ouvre... ou le souffle d'une baleine qui perce la surface de l'eau.
Tu as mentionné à quelques reprises, en entrevue, t’inspirer de tes propres expériences en tant que personne queer. En quoi celles-ci influencent-elles ton écriture dramaturgique et ta vision du théâtre en général?
J'ai une admiration totale et une incompréhension tout aussi totale devant les auteurs et autrices qui arrivent à écrire des fictions très éloignées d'elleux. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire.
Je raconte souvent que lorsque j'ai écrit ma pièce Faire des enfants, au départ, mon objectif était de ne pas écrire une pièce queer ou gaie. Pour celleux qui connaissent la pièce... vous savez que j'ai LAMENTABLEMENT échoué!
J'étais finissant·e à l'École nationale de théâtre et mon coach, Pierre Bernard, lisait mes premières ébauches et me disait, en gros, que c'était... bof. Le cœur n’y était pas. C'était habile, bien écrit, mais... rien ne vibrait. Et il ne me lâchait pas, il me talonnait pour que je creuse davantage. Un soir, je suis rentré chez moi en colère en me disant : « Tu veux que j'écrive ce que j'ai dans la tête, tiens, c'est ça que j'ai dans la tête »… Et j'ai écrit la première scène de Faire des enfants, qui est essentiellement un trip de cul et de drogue entre trois gars. J'étais convaincu que c'était médiocre, cliché, d'aucun intérêt. Quand j'ai revu Pierre, il m'a dit : bon, là tu tiens quelque chose.
La consommation, la sexualité et la recherche de soi et de l’amour des autres sont souvent abordées de manière interconnectée dans tes pièces. Pour toi, qu’est-ce que ces thématiques partagent entre elles?
Ces thématiques partagent une même pulsion, celle du désir, qui se transforme souvent en dépendance et qui finit par nous rendre moins libres. Le désir d’être touché·e, vu·e, aimé·e, reconnu·e, fondu·e dans l’autre. Le désir d’échapper à soi, ou au contraire de se retrouver, de s’atteindre enfin. C’est une énergie qui peut passer par le sexe, par les substances, par la parole, par la fuite, par la transe...
Ces fils-là — consommation, sexualité, recherche d'amour et recherche de soi dans l'autre — ont toujours été enchevêtrés dans ma vie. Je n’ai jamais vécu l’un sans l’autre. Tomber amoureux, c’était consommer l'autre. Me droguer, c’était chercher un contact. Baiser, c’était souvent une tentative désespérée de me trouver.
Je ne sais pas séparer ces choses-là dans l’écriture, parce qu’elles ne le sont pas dans l’expérience. Dans les dernières années, j'ai amorcé un travail de rétablissement de ma dépendance au crystal meth. Au départ, je voulais juste arrêter la drogue, mais j'ai vite réalisé qu'il me fallait adresser la question sexuelle, amoureuse, spirituelle parce que ce sont différentes portes qui mènent à la même pièce : celle où on essaie d’être soi-même, vivant·e, à la bonne place, pas seul·e.
La série de représentations à guichets fermés au Prospero témoigne clairement que ton écriture dépasse les frontières de la communauté qu'elle représente directement. Que penses-tu de cet engouement?
Je tiens d'abord à dire que c'est la communauté qui a créé ce succès : auteur queer, metteur en scène queer, acteur queer, plusieurs membres de l'équipe de création et conception queers, théâtre situé dans le village... La communauté s'est mobilisée autour du spectacle : chaque soir, la salle était pleine de spectateurices queers et je suis RAVI que ça ait été un succès par et pour la communauté.
Maintenant, bien sûr que la pièce peut résonner auprès de tout le monde. Je vais reproduire ici une réponse que j'avais écrite pour une entrevue parue dans la revue Jeu, où on m'avait demandé si la pièce s'adressait uniquement à la communauté gaie :
Les personnes queers sont habituées, dès l’enfance, à s’identifier à des personnages cis et à des histoires ancrées dans l’hétérosexualité. C’est une chance d’apprendre très tôt à avoir de l’empathie pour les personnes différentes de soi. Les hétéros n’ont souvent pas cette opportunité. On ne demande jamais, par ailleurs, à un auteur ou une autrice cis et hétérosexuelle si sa pièce s’adresse uniquement aux personnes cis et hétéros. On tient pour acquis qu’une pièce qui met en scène des personnages et des relations hétérosexuelles, où la culture dominante est représentée, parle à tout le monde.
Ma pièce met en scène un être qui traverse des états, des émotions et vit des transformations propres à la nature humaine, c’est seulement le contexte dans lequel il vit tout ça qui est propre à la culture gaie. Les personnes pour qui l’orientation sexuelle est une barrière à l’empathie ne passeront sûrement pas une super belle soirée, mais j’espère quand même qu’iels viendront. Ce spectacle s’adresse aux humain·es.
Comme tu sais, la plateforme Chez Manu appartient à la Chaire de recherche du Canada TRADIS. Quels conseils donnerais-tu à des personnes chercheuses qui s’intéressent aux enjeux qui ont été discutés?
Beaucoup de projets universitaires se sont penchés sur le chemsex, la dépendance, la sexualité queer. Dans le contexte actuel, où la communauté souffre énormément, je n’aurais qu’un seul conseil : GIVE BACK!
Aucun projet de recherche ne devrait être financé sans garantie d’impact positif et concret sur la communauté. Et ça ne devrait pas être un vœu pieux inscrit à la fin d’un protocole, mais une exigence structurante, dès le départ. De nombreuses recherches universitaires — parfois très bien financées — ont récolté des témoignages déchirants auprès de personnes queer, trans, racisées, vivant avec des dépendances, sans que ça ne se traduise par des retombées tangibles.
J’ai moi-même participé à plusieurs études universitaires en lien avec mon passé de chemsex, et ce depuis des décennies. Où en sommes-nous avec la dissémination du savoir pratique et de l’implantation des grandes recommandations, nombreuses et toujours isolées, peu politisées, et jamais implantées? Faisons-nous vraiment progresser les choses ou alors sommes-nous en train de garrocher du savoir complaisant sur le feu, question de l’alimenter et d'ainsi maintenir le statu quo qui semble profitable à plusieurs? Quels progrès ont été faits? Quels services pérennes, accessibles, efficaces ont été mis en place? Quelle stratégie nationale de santé publique existe aujourd’hui pour les usager·ères queers de crystal meth au Canada?
Plusieurs chercheur·es ont utilisé les souffrances de nos communautés pour bâtir leur carrière. Ce qui n’est acceptable que si, et seulement si, ils et elles redonnent ensuite aux communautés qui les ont propulsé·es.
Et ça, ce n’est pas une demande isolée ou idéaliste. Dans plusieurs pays, notamment dans les projets de recherche communautaire (community-based participatory research), les communautés queers refusent maintenant de participer sans que des engagements concrets de restitution soient clairement définis. Par exemple, dans l’étude Trans Teen and Family Narratives1, les jeunes trans et leurs familles n’étaient pas seulement participant·es : iels ont été intégré·es comme co-chercheur·es, ont participé à l’analyse des données, et ont orienté les recommandations finales. Ce type de démarche devrait être la norme.
Au Canada, la Politique des trois Conseils sur l’éthique de la recherche (EPTC 2) oblige déjà les chercheur·es à démontrer que les bénéfices pour la communauté l’emportent sur les risques. Elle insiste aussi sur le fait que les résultats doivent être diffusés dans des formats accessibles et culturellement adaptés. Autrement dit, publier un article dans une revue académique ne suffit plus. Les chercheur·es doivent planifier dès le départ comment les résultats seront partagés avec les milieux communautaires — que ce soit sous forme d’ateliers, de guides, d’outils pratiques ou de formations.
Enfin, j’ajouterais ceci : aucun projet de recherche sur nos communautés ne devrait voir le jour sans la participation directe de personnes concernées à toutes les étapes. Et cela inclut aussi la composition des comités d’éthique et d’évaluation. Trop souvent, ces projets sont approuvés sans regard réel sur les conséquences culturelles, sociales ou politiques pour les participant·es. Inclure des personnes queers, trans, racisées, issues de milieux populaires dans ces comités est une condition de base.
Parce que, oui, la recherche peut être utile. Elle peut transformer. Mais seulement si elle n’extrait pas des récits pour les capitaliser, seulement si elle donne du pouvoir, des ressources, du soutien en retour. Autrement, c’est de l’exploitation.
Dans quel état d’esprit te trouves-tu ces jours-ci? Travailles-tu sur un nouveau projet que tu serais prêt à partager avec nous?
2025 est une grosse année, pleine de transformations très positives sur le plan personnel et professionnel. C'est très étrange de vivre tout ça alors que le contexte mondial, lui, est très sombre, sur tous les plans. J'ai parfois de la difficulté à concilier les deux et le sentiment de culpabilité n'est jamais bien loin. Je suis souvent en colère et c'est une émotion avec laquelle je n’ai pas appris à composer souvent. Je suis reconnaissant·e d'avoir trouvé au fil des ans des outils pour nourrir une spiritualité qui me permet d'apprendre et d'être curieux de ces émotions-là, nouvelles, qui surgissent. De les transformer en action aussi souvent que possible.
J'ai plusieurs projets d'écriture à moyen terme et je termine présentement l'écriture d'un texte qui mijote en moi depuis plus de 10 ans! On travaille aussi avec l'équipe du Prospero à imaginer une reprise de Ces regards amoureux de garçons altérés, possiblement la saison prochaine, ce qui serait vraiment formidable.
Mais je dirais que ce qui m'occupe le plus, c'est mon nouveau poste de direction artistique et co-générale du Jamais Lu. J'entame ma première saison au sein de l'organisme, alors tout est nouveau, tout est à faire. C'est un organisme auquel je dois énormément et qui a transformé le parcours de tellement d'artistes. Je veux m'y consacrer avec toute mon énergie et tout mon amour·e.
La chaire TRADIS remercie Éric pour sa participation à cette entrevue et le félicite pour son prix Michel-Tremblay. Ses réponses, riches de sens, ne manqueront pas de nourrir nos réflexions.
À partir de septembre 2025, Éric Noël succèdera à Marcelle Dubois à la direction artistique et la co-générale du Festival du Jamais Lu, un organisme dédié à la découverte d'écritures dramatiques contemporaines. À travers les années, ce sont plus de 350 dramaturges qui ont vu leurs textes inédits rayonner sur les scènes de Tiohtià:ke/Montréal, Québec, Paris, Lamentin (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique) et sur les routes du Québec grâce aux différentes éditions du Festival. Dans ces nouvelles fonctions Éric Noël souhaite « honorer l’impulsion originelle, toujours vibrante, du Jamais lu » en assurant une programmation inclusive et diversifiée où toute personne est la bienvenue. Pour en apprendre plus sur le Festival du Jamais Lu... https://jamaislu.com/
Et pour en découvrir plus sur Éric, l'humain et son histoire, vous pouvez visionner son témoignage dans le projet vidéo Ça prend un Village.
